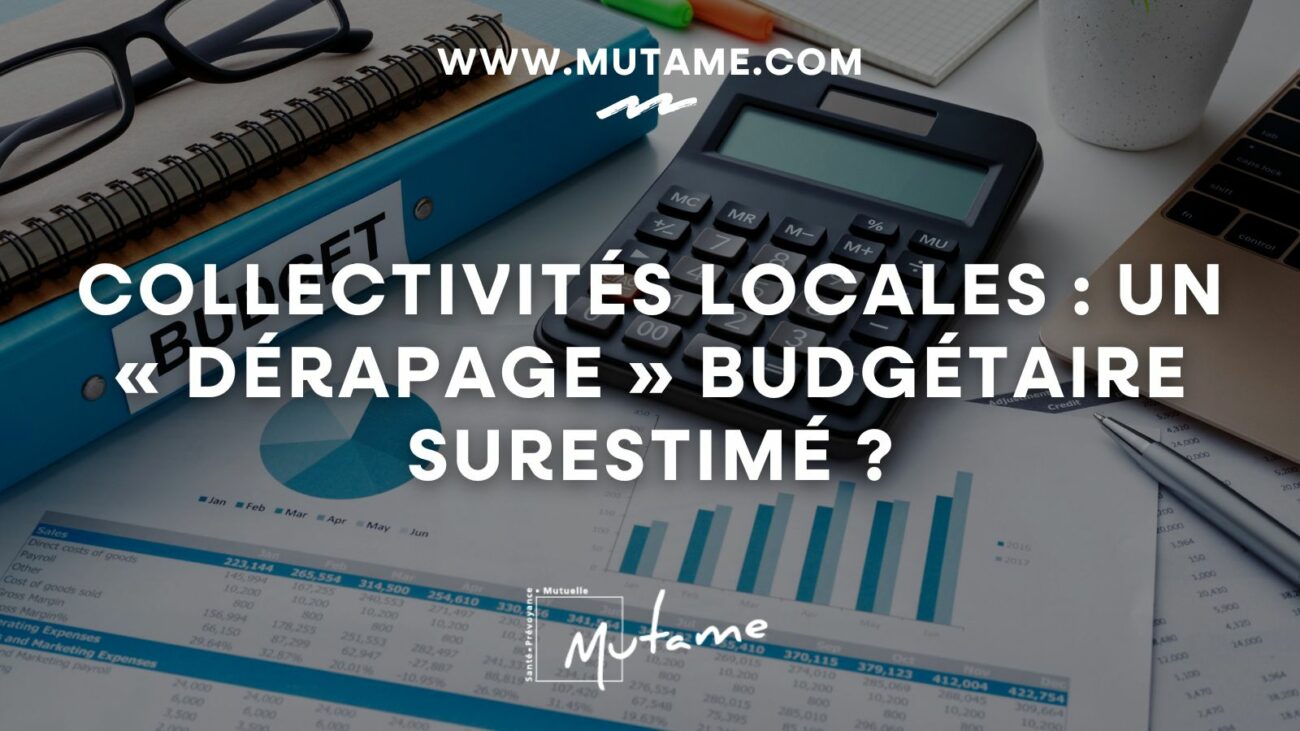Docteure en pharmacie et conseillère technique à la Haute autorité de santé (HAS), Anne-Sophie Grenouilleau a coordonné le rapport d’analyse prospective « Sexe, genre et santé » mené en 2020. Elle y défend l’idée qu’une meilleure prise en compte des différences de sexe et de genre permettrait d’améliorer la santé des femmes, des hommes, des personnes intersexes et trans. Deux ans après sa publication, quelle est la situation ?

France Mutualité. Pouvez-vous revenir sur les enjeux du rapport « Sexe, genre et santé » réalisé par la HAS à destination du gouvernement et du Parlement ?
Anne-Sophie Grenouilleau. Les rapports d’analyse prospective annuels ont principalement pour but de proposer des pistes d’amélioration de notre système de santé. Dans ce domaine, nous avons en effet constaté que certains stéréotypes liés au genre et au sexe sont sources d’inégalités et empêchent une prise en charge optimale des patients. Nous avons donc choisi d’en faire le sujet de ce troisième rapport d’analyse prospective. Car mieux intégrer ces différences en santé serait bénéfique pour l’ensemble de la population. En plus d’être un sujet de santé, ce rapport traite d’un réel sujet de société. Il a d’ailleurs reçu un très bon accueil, notamment auprès du grand public et des minorités sexuelles et de genre, qui ont apprécié le fait que la HAS s’intéresse à ce sujet et ne se limite pas à la binarité femme-homme.
F. M. D’où viennent ces stéréotypes ? Et quels en sont les principaux risques ?
A-S. G. Je ne suis pas une sociologue, mais il me semble clair que ces idées reçues, ces normes sociales, sont présentes chez tout le monde (soignants, institutions, décideurs publics, usagers…) et créent un carcan dont il est difficile de s’extraire. Cela est lié à notre histoire collective, à notre culture et à notre histoire de la médecine aussi, construite majoritairement par des hommes.
Je distingue principalement deux problématiques : l’une concerne la binarité femme-homme qui mériterait plus de souplesse ; l’autre repose sur une théorie qui suppose que tout ce qui va être valable chez les hommes (au sens masculin) l’est implicitement pour l’ensemble de la race humaine.
De ces stéréotypes naissent des réponses inadaptées : on peut ainsi passer à côté d’une maladie, se tromper de diagnostic et ne pas soigner, accompagner ou prendre en charge les personnes moins bien qu’on pourrait le faire.
F. M. Justement, en quoi ces idées reçues impactent-elles la santé ?
A-S. G. Il faut savoir faire preuve de nuance : nous savons par exemple qu’en cardiologie, les symptômes de l’infarctus et la façon de les dire ne sont pas les mêmes chez l’homme et chez la femme. Pour autant, on a tendance à généraliser les symptômes dits « masculins », ce qui engendre un retard de diagnostic (chez les femmes, les symptômes sont fréquemment confondus avec des crises d’angoisse) et de prise en charge de la « crise cardiaque ».
De même, comment se fait-il que l’endométriose et son diagnostic aient été si longtemps ignorés ? Durant des années, ce sujet n’a pas été identifié comme étant une question de santé à part entière. La douleur pendant les règles était jugée comme habituelle, et cette normalisation a occulté le problème. On constate un réel manque de travaux de recherche sur la santé des femmes.
La santé des hommes connaît elle aussi son lot de stéréotypes et de désintérêt : leur espérance de vie, par exemple, est sensiblement moindre que celle des femmes, mais on ne s’en préoccupe pas. L’Organisation mondiale santé (OMS) a récemment porté le sujet de la santé des hommes dans la zone Europe, on voit donc que les lignes bougent. Il me semble que dans ces deux exemples où le sujet a été considéré comme une fatalité, on s’est dit que c’était inéluctable, et on ne s’y est pas intéressé. C’est contre cela qu’il faut lutter.
F. M. En 2020, votre rapport appelait à dépasser la binarité pour une considération « globale et nuancée » des questions de genre. Constatez-vous une amélioration ?
A-S. G. Notre travail est encore récent, et nous n’avons pas vocation à faire une étude d’impact. Mais nous constatons, à travers les médias ou certaines études, que le secteur de la santé développe un intérêt grandissant pour ces questions. Le sexe et le genre sont désormais bien identifiés comme étant des facteurs importants. On note même une forte appétence des jeunes générations pour ces sujets, comme pour la question de la transidentité. Ces interrogations qui animent la société influent désormais dans le secteur de la santé.
F. M. Les acteurs de santé sont-ils selon vous assez sensibilisés et formés au sujet ?
A-S. G. Le secteur a identifié qu’il y avait un réel manque dans le domaine de la formation ou de la recherche, lié notamment à un manque de préoccupation. Mais il se passe des choses. J’ai par exemple été sollicitée par l’Université de Paris pour intervenir sur la question du genre auprès d’étudiants destinés aux études de santé. Soit, il n’y a pas encore d’enseignement à l’échelle nationale et ces formations restent à l’initiative des universités, mais c’est un bon début.
La formation médicale s’ouvre aussi à la formation sociale, et donc inévitablement aux questions de genre. Ces sujets demandent du temps.
F. M. Pourquoi la santé féminine demeure-t-elle si peu étudiée ?
A-S. G. Pendant longtemps, la médecine a été dominée par des hommes. Mais depuis quelques années, on assiste à un décloisonnement, même si, il est vrai, le sujet des recherches porte encore beaucoup sur la santé reproductive ou sexuelle. Ces questions de santé vont bien plus loin, car il s’agit aussi de questions de droits. Et même si cet intérêt nouveau pour la santé des femmes est une bonne chose, il ne doit pas pour autant occulter celui porté aux autres groupes.
F. M. Les algorithmes et l’intelligence artificielle (IA) permettront-ils d’apporter cette nuance souhaitée ?
A-S. G. En réalisant des propositions de diagnostics ou de traitements, les outils numériques sont des aides pour les soignants. Mais en effet, si les données sont issues de recherches réalisées uniquement sur des hommes, bien évidemment, ces innovations ne feront que répéter, voire accentuer la disproportion qu’il peut y avoir entre les sexes. De même pour la question du genre. Nous avions déjà signalé ces risques dans un précédent rapport de la HAS intitulé « Numérique : quelle (R)évolution ? » (2019). Nous devons nous intéresser à la représentativité des bases d’entraînement et de tests de ces algorithmes pour éviter qu’ils véhiculent ces généralités, et se transforment à terme en « mauvaise aide ».
Les 10 propositions de la HAS pour améliorer la santé de tous
- Encourager la prise de conscience des acteurs.
- Intégrer le sexe et le genre dans la conception des politiques publiques sociales et de santé.
- Construire leur mise en œuvre avec les populations concernées.
- Évaluer a posteriori les politiques publiques au prisme du sexe et du genre lorsque c’est pertinent.
- Mobiliser la statistique publique en la rendant accessible en open data, et en faisant notamment apparaître la sexo-différenciation dans les travaux.
- Considérer explicitement le sexe dans les essais cliniques sur les produits de santé et les actes médicaux.
- Les données de statistique publique et les données de vie réelle devraient être ventilées par sexe, et leur analyse devrait être faite au-delà d’une simple présentation en deux colonnes (femmes-hommes).
- Faire évoluer les formations initiales et continues tant dans le champ social, que dans le champ médico-social ou sanitaire.
- Adapter la méthodologie pour élaborer des recommandations avec la prise en compte du sexe et du genre des personnes.
- Accorder une préoccupation particulière pour les personnes intersexes et les personnes trans.