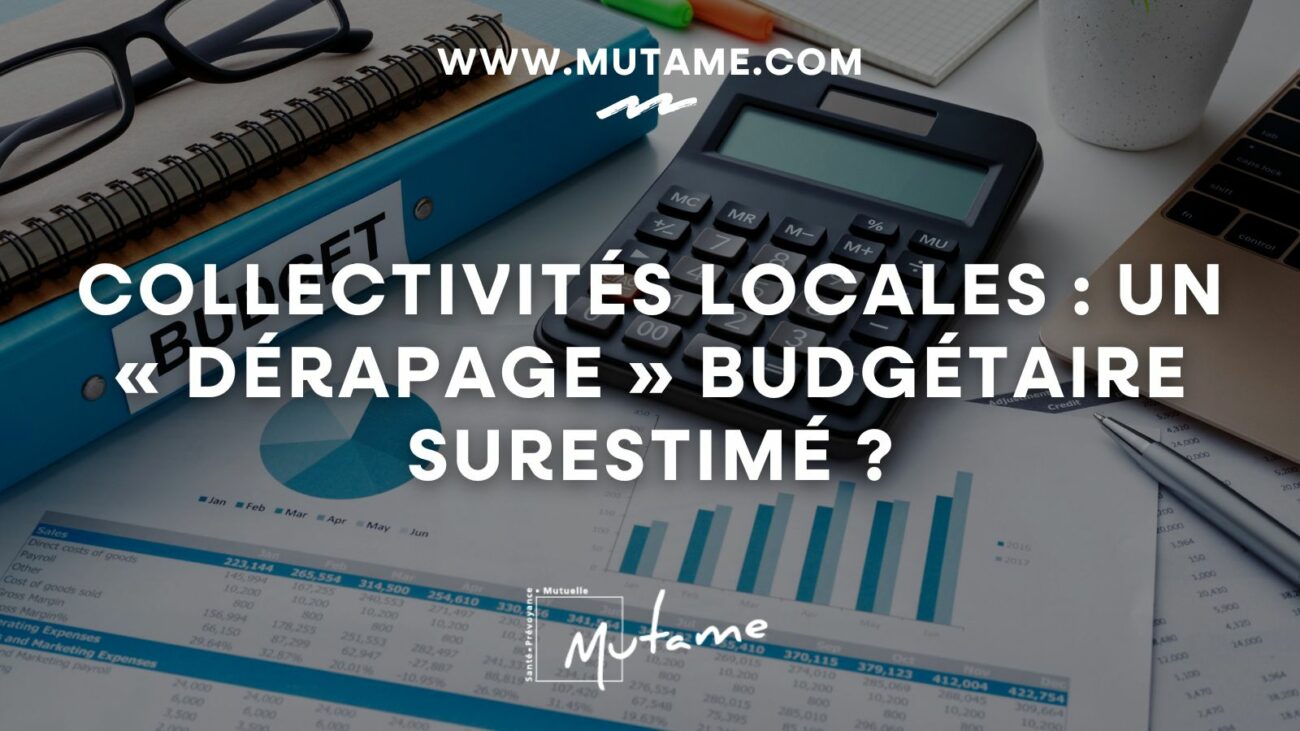Chaque année, 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. Les impacts environnementaux de l’industrie textile sont devenus considérables : elle génère de grandes quantités de gaz à effet de serre, pollue les sols, les océans, et utilise 4 % de l’eau potable de la planète.

Du côté des ouvriers du secteur, dont la production est désormais essentiellement située au Bangladesh et au Pakistan, les ONG dénoncent des conditions de travail épouvantables. À notre niveau, est-il possible d’agir pour inverser la tendance ? Toutes les réponses dans notre dossier.
Une machine devenue folle. C’est un peu l’impression que donne l’industrie de l’habillement aujourd’hui. Les grandes marquent internationales renouvellent leurs collections à un rythme effréné et proposent sans cesse de nouvelles pièces à des prix défiants toute concurrence. Nous vivons sous le règne de ce que l’on appelle la « fast fashion ». Les adeptes de la mode accumulent les vêtements sans compter et les tenues se succèdent d’une saison à l’autre avant d’être reléguées au placard puis jetées. Si nous achetons deux fois plus d’habits qu’il y a 15 ans, nous les conservons aussi moins longtemps.

Selon Greenpeace, chaque année 100 milliards de vêtements sont vendus sur la planète. Et entre 2000 et 2014, leur production a tout bonnement doublé. Or, si la mode et le prêt-à-porter génèrent de nombreux emplois (580 000 en France selon l’Institut français de la mode), c’est aussi une des industries les plus polluantes de la planète.
L’Industrie textile, le troisième consommateur d’eau dans le monde
« L’impact majeur de la fast fashion sur l’environnement, c’est la surproduction et donc l’exploitation extrême et le pillage de nos ressources naturelles », précise Hélène Sarfati-Leduc, consultante en développement durable auprès d’entreprises de la mode, de l’habillement et du luxe (Le French bureau). Pour obtenir du coton, par exemple, il faut des quantités astronomiques d’eau (l’équivalent de 70 douches pour un seul tee-shirt), sans parler des pesticides et des engrais qui finissent dans les nappes phréatiques et les cours d’eau.
Ce n’est pas tout : « Pour arriver jusqu’à votre étagère, un jean peut parcourir jusqu’à 65 000 kilomètres depuis le champ de coton. La chaîne de valeur (de production, NDLR) est tellement éclatée que les produits font plusieurs allers-retours dans le monde. Et cela génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre », ajoute Hélène Sarfati-Leduc. D’après une estimation de la Fondation environnementale Ellen-MacArthur, le transport des matières premières et des produits de l’habillement ne recouvre cependant que 2 % des émissions totales produites par l’industrie de la mode. À elle seule, la fabrication de coton, de matières synthétiques et naturelles émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an.
Microfibres plastiques
Autre exemple avec le polyester. Cette matière première, la plus utilisée pour la fabrication de nos vêtements, provient d’une ressource fossile limitée : le pétrole. À chaque lavage, ces habits relâchent des microfibres plastiques que l’on retrouve dans l’océan et qui mettent des décennies à se dégrader. Tous les ans sur la planète, environ 500 000 tonnes de microparticules polluent ainsi les mers, soit l’équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique, selon la Fondation Ellen-MacArthur (lire aussi notre encadré « Lavage : comment limiter les dégâts »). C’est aussi dans les rivières, les fleuves et les mers que l’on retrouve les résidus hautement toxiques des produits utilisés pour la teinture des tissus (éthoxylates de nonylphénol (NPE), colorants azoïques, phtalates et formaldéhyde, un cancérigène).
Même les matières prometteuses comme la viscose et le lyocell, présentées comme alternatives au coton et au polyester, ont des conséquences sur l’environnement. Ce sont des fibres artificielles mais obtenues à partir de la cellulose de bambou, de maïs ou encore de soja. Pour les fabriquer, on utilise des produits chimiques toxiques comme l’hydroxyde de sodium, l’acide sulfurique et le disulfure de carbone. Ce liquide, « hautement volatil et inflammable, provoque de graves maladies pour les populations aux alentours des usines », souligne l’Ademe (Agence de la transition écologique).

La matière première de nos habits vient aussi des animaux (laine de mouton, de chèvre ou d’alpaga, fourrure de vison ou de lapin, cuir de veau, de vache ou d’agneau). Ces animaux vivent souvent « dans des conditions difficiles, le plus souvent confinés, sous-alimentés, voire maltraités », ajoute l’agence.
Impact social catastrophique
Quant aux êtres humains, la facture est, là aussi, bien salée. Ces dernières années, face à l’augmentation des salaires et des coûts de production dans les pays occidentaux et le Maghreb, les marques se sont tournées vers de nouveaux sites moins chers, notamment au Bangladesh et au Pakistan. « Jusqu’en 2005, les pays en voie de développement ou l’Asie ne pouvaient pas exporter vers l’Europe au-dessus d’un certain quota déterminé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), explique Hélène Sarfati-Leduc. En 2005, ces quotas ont été levés et ça a été la porte ouverte à la fast fashion. Toutes les grandes marques sont allées produire leurs vêtements là où la main-d’œuvre ne coûte rien et travaille dans des conditions épouvantables. »
Au Bangladesh, le salaire d’un ouvrier dans le textile est le plus bas au monde, soit 0,3 dollar de l’heure. Au Pakistan, le chiffre monte à 0,5 dollar, alors qu’en France il faut compter 31,5 dollars. Dans ces pays, les capacités de production n’ont pas su s’adapter à l’explosion de la demande occidentale et les accidents industriels sont extrêmement fréquents.
Gâchis phénoménal
Au final, la fast fashion se résume à ça : « Faire beaucoup d’habits, rapidement, avec une durée de vie très limitée, aller chercher les zones de production où les salaires sont les plus bas et les règles sociales et environnementales les plus faibles pour avoir des coûts très bas et pouvoir vendre des vêtements à bas prix, très vite renouvelables, très vite jetés, et qui n’obéissent à aucune règle sociale et environnementale », se désole la spécialiste.
Et nous, que faisons-nous de toutes ces tenues une fois achetées ? Combien de temps les portons-nous réellement ? Pour certaines personnes, seulement une dizaine de fois avant de s’en débarrasser.
Selon l’Agence européenne de l’environnement (European Environment Agency – EEA), un tiers de la garde-robe des Européens ne serait pas sorti de leur penderie depuis au moins un an. Un comble quand on sait qu’un Européen achète en moyenne 12,6 kilos de vêtements par an. Aux États-Unis, le chiffre grimpe même jusqu’à 16 kilos, précise Greenpeace. Ces quantités considérables entraînent inexorablement un volume de déchets textiles phénoménal, soit 2,1 milliards de tonnes par an. En Europe, on se débarrasse annuellement de 4 millions de tonnes de textiles, « dont 80 % sont jetés dans la poubelle pour les ordures ménagères et finissent par être tout simplement enfouis ou incinérés », précise l’Ademe.
Vers une production et une consommation raisonnée
Parallèlement, dès le début des années 2000, l’idée d’une mode éthique commence à émerger avec la prise de conscience des enjeux climatiques. En France, l’association Universal Love fonde le salon Ethical Fashion Show en 2004 pour mettre en lumière les créateurs qui respectent l’environnement, l’humain et les savoir-faire de qualité. « En 2011, nous avions plus d’une centaine de marques engagées avec nous à l’international, explique Isabelle Quéhé, fondatrice et directrice artistique de l’association. Nous avons fait de nombreuses conférences pour informer les acheteurs et les acteurs de la mode sur l’urgence et l’importance d’aller vers un marché plus responsable. Et puis, les conséquences de la crise de 2008 ont commencé à se faire sentir et les choses sont devenues vraiment compliquées, surtout pour la mode éthique. »
Finalement, il faudra attendre la tragédie du Rana Plaza pour que les choses commencent à bouger. En 2013, cet immeuble de Dacca, au Bangladesh, où des milliers d’ouvriers du textile travaillaient pour les sous-traitants de grandes marques occidentales, s’effondre. Bilan : 1 138 morts et 2 500 blessés.

Devoir de vigilance des multinationales de l’industrie textile
Suite à ce terrible événement, les lois ont évolué et il existe, depuis 2017, un devoir de vigilance des multinationales françaises dans leurs filiales et leurs chaînes d’approvisionnement à l’étranger. Le texte précise que ces entreprises doivent désormais rédiger un plan pour identifier « les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement ».
Une belle victoire pour les ONG (Greenpeace, Human Rights Watch, Oxfam…) et les associations, comme le collectif Éthique sur l’étiquette, membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, qui milite pour le respect des droits humains et le droit à l’information des consommateurs, ou comme le mouvement Fashion Revolution. Ses membres continuent d’œuvrer à la sensibilisation du grand public en commémorant chaque année le drame du Rana Plaza avec une semaine d’actions et d’informations (lire aussi notre encadré « Une appli et un hashtag pour une mode plus responsable »).
Recyclage et seconde main
Mais, de notre côté, simples consommateurs, que faire pour inverser la tendance ? « Déjà, il faut commencer par réduire ses achats, essayer de réparer un vêtement quand il est abîmé et acheter uniquement ce dont on a vraiment besoin, de préférence des pièces bien finies avec des matières naturelles, conseille Isabelle Quéhé. On peut aussi aller dans les vide-greniers, les recycleries et les friperies, qui vendent des choses pratiquement neuves. »
Pensez également à Emmaüs, qui permet à ses salariés de se réinsérer dans la vie active. « Chez les 20-35 ans, cette nouvelle façon de consommer est déjà bien intégrée, se réjouit Hélène Sarfati-Leduc. Les jeunes privilégient la seconde main parce qu’ils n’ont pas forcément envie d’avoir les mêmes fringues que les autres. Ils sont aussi mieux informés des enjeux sociaux et environnementaux de la mode. » Toujours dans cette idée d’économie circulaire, vous pouvez aussi vous tourner vers les plateformes comme Vinted ou Leboncoin.
Labels environnementaux
Autre conseil : privilégiez les habits certifiés par les labels environnementaux, comme l’Ecolabel européen, qui promet notamment 95 % de coton biologique pour les vêtements des enfants de moins de trois ans. Ce label garantit également « des procédés de fabrication plus propres, une qualité élevée des textiles et leur durabilité, explique l’Ademe. Il s’assure aussi du respect des droits fondamentaux sur les lieux de travail et limite l’utilisation des substances nocives dans les fibres textiles ». D’autres labels proposent plus ou moins les mêmes garanties, comme Demeter, Global Organic Textile Standard (GOTS), BioRé ou encore Oeko Tex Standard 100. Généralement plus chers que les produits de la fast-fashion, ces vêtements labellisés sont aussi de meilleure qualité et durent bien plus longtemps.
Enfin, préférez les fibres dont la culture réclame moins d’eau et de pesticides, comme le lin ou le chanvre. Vous pouvez aussi opter pour la polaire, issue du recyclage des polyesters et des bouteilles plastiques. Et puis, si un jeune créateur s’installe près de chez vous, « n’hésitez pas à aller le voir, à discuter et à acheter local », ajoute Isabelle Quéhé. Pour la jeune femme, le changement viendra des consommateurs et non des grandes marques. « Il faut leur faire comprendre que la mode de demain sera éthique ou ne sera pas », conclut-elle.
Une appli et un hashtag pour une mode plus responsable
L’application Clear Fashion évalue les marques des vêtements et leur impact sur la planète selon quatre critères : « environnement », « santé », « humains » et « animaux », en leur attribuant une note sur 100. Il suffit de la télécharger sur son portable puis de scanner l’étiquette de l’habit que vous avez repéré. Autre démarche mais même objectif avec l’association Fashion Revolution. Tous les ans, pendant une semaine en avril, pour commémorer l’effondrement du Rana Plaza, en Inde, où 1 138 ouvriers du textile sont morts en 2013, les consommateurs sont invités à se prendre en photo avec l’étiquette d’une pièce de leur dressing. Ils postent ensuite cette photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WhoMadeMyCothes. L’idée est ici d’interpeller les marques et de les inciter à être plus transparentes sur leurs process de production.
Lavage des habits : comment limiter les dégâts
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime que plus du tiers des microplastiques rejetés dans les mers provient du lavage des textiles. « Les microparticules de nylon, polyester, élasthanne ou acrylique émanant de nos vêtements sont trop petites pour être filtrées par les stations d’épuration et finissent leur course dans l’océan », précise de son côté l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). À cela s’ajoutent aussi toutes les substances chimiques utilisées pour les teintures et pour fixer les couleurs. Enfin, les lessives que l’on utilise peuvent aussi être très polluantes, surtout si elles contiennent des parfums et des tensioactifs. L’Ademe recommande donc de limiter les machines, de ne pas laver à plus de 30° et de privilégier les lessives certifiées par des labels comme l’Ecolabel européen. Évitez aussi les adoucissants (pleins de parfum) et préférez le séchage à l’air libre.